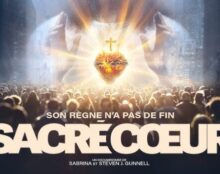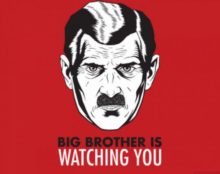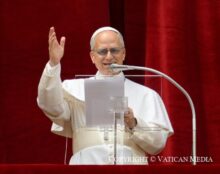Sacré-Coeur disponible en DVD et VOD
Le film phénomène SACRÉ CŒUR, des réalisateurs Sabrina et Steven J. Gunnell, est disponible en VOD sur la plateforme SAJE+ et sur les plateformes VOD (MyCanal, Itunes, Orange…), et en DVD dans toutes les librairies (et sur la boutique en ligne La Boutique SAJE).
Le film cumule près de 500 000 entrées en France et près de 40 000 entrées supplémentaires à l’international. Il a déjà été diffusé en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, à Monaco, en Tunisie, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, en RDC, au Bénin, au Burkina Faso, Togo et au Liban. Il sera diffusé prochainement en Italie, en Pologne, en Espagne, en Allemagne, au Mexique, au Canada et enfin, aux Etats-Unis du 9 au 14 juin 2026, à la faveur de la consécration des Etats-Unis au Sacré Cœur par les évêques Américains.
Deux médecins américains condamnés pour l’ablation des seins d’une adolescente
Aux Etats-Unis, un tribunal de l’État de New York a condamné vendredi un psychologue et un chirurgien esthétique pour faute professionnelle, à la suite de la plainte d’une jeune femme regrettant sa mastectomie, subie à l’âge de 16 ans.
C’est un jugement inédit, qui pourrait faire date aux États-Unis et même au-delà.
La victime avait porté plainte en 2023 contre son psychologue ainsi que le chirurgien esthétique, pour ne s’être pas suffisamment assurés qu’elle avait consenti de façon éclairée à cette opération d’ablation de la poitrine. Le tribunal lui a accordé 2 millions de dollars de dommages et intérêts.
Aux côtés de sa mère, la jeune femme aujourd’hui âgée de 22 ans a témoigné devant le tribunal de son histoire tumultueuse et des difficultés qu’elle a connues dans l’acceptation de sa puberté et de son identité féminine. Son récit est celui d’une petite fille puis d’une adolescente dont le mal-être n’a cessé de croître tout au long de l’enfance : ses parents se sont séparés quand elle avait 7 ans, puis se sont disputé sa garde pendant trois années supplémentaires, avant qu’elle et sa mère ne coupent les liens avec le père. Isabella Varian souffrait de problèmes psychiques, notamment d’anxiété et de phobie sociale, avant d’être diagnostiquée d’un trouble du spectre autistique. On l’a changée d’école à plusieurs reprises. Elle est devenue anorexique, avait du mal à accepter l’image renvoyée par son corps. Là-dessus, sont arrivées ses premières règles, et avec elles un changement brutal dans la perception qu’elle avait d’elle-même au seuil de l’adolescence. Les échanges avec son psychologue portent sur son identité de genre, et finissent par la convaincre qu’elle est née dans le mauvais corps, qu’elle n’est sûrement pas une femme.
Vers l’âge de 15 ans, la jeune fille a décidé de ne plus se faire appeler Isabella mais Gabriel, un prénom volontairement androgyne, puis s’est coupé les cheveux et a commencé à se bander la poitrine alors que ses seins commençaient à apparaître. Puis elle a opté pour le prénom Rowan, et a déclaré à son entourage qu’elle était transgenre. Elle a commencé alors une transition sociale : autour d’elle, il faudrait désormais la considérer comme un garçon, s’adresser à elle en employant des pronoms masculins.
En décembre 2019, près d’un an après le début de cette transition publique, la jeune fille a été opérée par le Dr Chin qui a pratiqué sur elle une mastectomie, une opération mammaire visant à retirer la poitrine d’une femme, plus couramment pratiquée dans le traitement du cancer du sein. Aux États-Unis comme en France, le nombre d’enfants trans ayant subi une mastectomie a été multiplié par 10 au cours des dernières années ; au moins 776 adolescents américains âgés de 13 à 17 ans ont subi cette opération entre 2019 et 2021, selon un décompte repris par Reuters et fondé sur l’analyse des données de l’assurance maladie.
Pour expliquer aujourd’hui le choix qu’elle a fait à l’époque, la jeune femme, âgée de 22 ans et qui se fait à présent appeler Fox, explique à la barre du tribunal :
«Je ne me sentais plus en sécurité en tant que femme. […] Je crois que le fait d’être perçue comme une femme me dérangeait, non pas parce que j’étais un homme, mais parce que je ne voulais pas qu’on me voie comme une femme.» «Je pense qu’il y a une différence entre vouloir être un homme, et ne pas vouloir être une femme, ne pas vouloir affronter tout ce que cela implique.»
Elle regrette dorénavant une opération dont les conséquences sont par nature en partie irréversibles. Sa «détransition» a commencé trois ans après sa mastectomie.
Le Dr Einhorn, le psychologue qui avait accompagné Fox Varian tout au long de son parcours de transition et avait donné son assentiment à cette opération, a reconnu devant le tribunal éprouver de la «honte» en raison de sa «faute professionnelle» après le témoignage de la jeune femme, au contraire du Dr Chin.
Projet d’aide à mourir: des conditions strictes? Par le Pr Aline Cheynet de Beaupré
Lien de la vidéo ( hébergée sur mon blog Sergyl Lafont, avec l’accord de l’auteur).
https://www.youtube.com/shorts/iiU4GgQAhNA
Ci-dessous le texte:
🔴 “Aide à mourir” : des “conditions strictes” pour demander la mort ?
Non, si on lit le texte (en 1 minute 40…).
par Aline Cheynet de Beaupré
Les conditions d’éligibilité sont posées à l’article 4 de la proposition de loi.
Elles supposent :
🟣 Une affection (maladie ou handicap)
– grave et incurable (tous les handicaps répondent à ces critères et de très nombreuses maladies (ALD…) aussi)
– qui engage le pronostic vital,
🕳️ en phase avancée : la Haute Autorité de Santé a dit être incapable de diagnostiquer la mort à moyen ou long terme. Alors on évoque un “processus irréversible” (le handicap est irréversible…), une “aggravation de l’état de santé” (très fréquent) qui “affecte qualité de vie” (n’est-ce pas toujours le cas ?)
🕳️ou en phase terminale (déjà prévu par la loi de 2016 avec la sédation profonde et continue jusqu’au décès pour les personnes en souffrance, sans provoquer la mort pour autant).
🟣 Une souffrance (subjectif, on ne parle pas ici de “douleur”) physique ou psychologique (toutes les souffrances sont donc éligibles) qui est :
🕳️ soit réfractaire aux traitements (très fréquent)
🕳️ soit insupportable selon la personne qui choisit de ne pas recevoir ou d’arrêter un traitement (la personne choisit elle-même de se rendre éligible à la mort)
🔴 Les médecins ont calculé qu’au vu de ces critères, 1 million de Français sont éligibles à mourir…
Ce ne sont pas des conditions strictes.
Ca va trop loin.
Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.
Une église menacée de démolition en Mayenne
L’association “Urgences Patrimoine ” se mobilise pour sauver l’église, en partie millénaire mais en mauvais état, du hameau de Saint-Gault en Mayenne. Faute de pouvoir financer sa restauration, la municipalité a choisi de démolir l’édifice, désaffecté depuis longtemps et dont le diocèse a acté la désacralisation en novembre dernier.
Théodore Catry, avocat de l’association, explique :
“Nous nous appuyons sur l’article L421-6 du code de l’urbanisme, qui peut faire barrage à une démolition si elle porte atteinte à la conservation du patrimoine”
Il a adressé lundi 2 février au tribunal administratif de Nantes, alors que l’évacuation du mobilier de l’édifice avait déjà commencé, une requête en référé visant à obtenir une “mise en pause” de la décision de démolir l’église.
Urgence Patrimoine. mis en ligne une pétition rassemblant aujourd’hui 25000 signataires.
L’église doit être “déconstruite” pour n’en conserver que la base des murs et reconvertie en “lieux de souvenir” ouvert à tous. La municipalité de Quelaines-Saint-Gault a choisi cette option au vu du coût que représenterait une restauration.
“Cette église remonte en partie au XIe siècle, et même si elle n’est effectivement pas en bon état, il y a forcément d’autres solutions à envisager. Des cas similaires ont existé ailleurs en France !”
L’église du hameau de Saint-Gault fait l’objet d’une “demande de mise en instance de classement” en cours d’instruction et “la Direction régionale des affaires culturelles comme l’Architecte des bâtiments de France ont reconnu son intérêt patrimonial et démenti l’état de péril que revendique le maire pour justifier son projet”.
Le maire de Quelaines-Saint-Gault, en accord avec les services de l’Etat, a suspendu les travaux dans l’attente de l’ordonnance de référé.
L’émission #FaceALinfo vous le révélait en EXCLUSIVITÉ ce mardi.
Cette Eglise du XIe siècle sera démolie.Signez la pétition.
🔴 https://t.co/3Rq4cwtQCU pic.twitter.com/FXuU9MWSco— Christine KELLY (@christine_kelly) February 4, 2026
Le préfet du Dicastère de la doctrine de la Foi va rencontrer le supérieur de la FSSPX
Le cardinal Víctor Manuel Fernández rencontrera la semaine prochaine le supérieur général de la Fraternité Saint-Pie-X, l’abbé Davide Pagliarani.
Le cardinal Fernández a déclaré au journal The Pillar le 4 février que la lettre à laquelle Pagliarani faisait référence avait été envoyée par le Dicastère pour la Doctrine de la Foi. Le préfet a déclaré que la lettre « répondait simplement par un refus à la possibilité de procéder dès maintenant à de nouvelles ordinations épiscopales ».
Plusieurs sources ont indiqué à The Pillar que des conversations antérieures impliquaient également les deux évêques de la FSSPX, Mgr Bernard Fellay et Mgr Alfonso de Galarreta, et du côté du Vatican, le cardinal Kurt Koch, préfet du Dicastère pour la promotion de l’unité des chrétiens, et l’archevêque Guido Pozzo, ancien secrétaire de la Commission pontificale Ecclesia Dei, aujourd’hui disparue.
Le cardinal Fernández a indiqué que la prochaine réunion se limiterait à lui et à l’abbé Pagliarani.
Le pape François a accordé aux prêtres de la FSSPX la faculté d’entendre les confessions pendant l’Année de la Miséricorde en 2015, puis a prolongé cette faculté indéfiniment. François a rencontré en 2016 le supérieur de la FSSPX de l’époque, Mgr Bernard Fellay. « À l’issue de la réunion, il a été décidé de poursuivre les échanges en cours. Le statut canonique de la fraternité n’a pas été abordé directement, le pape François et l’évêque Fellay ayant estimé que ces échanges devaient se poursuivre sans précipitation. »
En 2017, Mgr Guido Pozzo, secrétaire de la Commission pontificale Ecclesia Dei, chargé du dialogue avec la FSSPX à l’époque, a déclaré qu’un groupe de travail « travaillait actuellement à l’amélioration de certains aspects de la structure canonique [de la FSSPX], qui sera une prélature personnelle », indiquant qu’un accord potentiel pourrait être imminent.
En 2017, le pape François a également déclaré que, dans des circonstances très limitées, les évêques diocésains pouvaient donner aux prêtres de la FSSPX la faculté de célébrer validement des mariages catholiques.
La même année, Mgr Fellay, alors supérieur, a affirmé avoir reçu en 2016 une lettre de Rome indiquant que la FSSPX pouvait ordonner des prêtres sans l’autorisation de l’ordinaire du lieu.
Les concessions sacramentelles de Rome se sont concentrées sur le bien spirituel des catholiques fréquentant les chapelles administrées par la FSSPX, le pape François soulignant qu’il ne voulait pas que les catholiques fréquentant ces chapelles soient privés de la possibilité de se confesser ou de se marier validement.
Le réveil du néant : quand l’angoisse devient un motif de mort
On se lève ce matin avec la sensation d’une « gueule de bois » éthique, abasourdi par ce qui s’est joué hier à l’Assemblée nationale. Le réveil est douloureux : la France s’est réveillée dans un monde où les derniers remparts de la civilisation ont vacillé. Ce que les adeptes de la « biologie heureuse » ont acté hier, ce n’est plus une loi de compassion, mais le triomphe d’un nihilisme qui ne prend même plus la peine de se cacher.
Alors que l’on nous promettait des conditions « strictes », le masque est tombé. Le bilan de la journée d’hier est un séisme anthropologique : les députés ont ouvert les vannes de l’irréparable en incluant la seule souffrance psychique comme critère d’accès à la mort provoquée.
L’administration du désespoir
La liste des motifs d’éligibilité qui ressort des débats hier soir donne le vertige. Ce matin, l’angoisse permanente, le sentiment de vide, la fatigue psychique ou même la peur de ne jamais aller mieux sont devenus des raisons suffisantes pour que l’État organise la fin d’une vie.
Le deuil et le choc du diagnostic : Désormais, le choc légitime qui suit l’annonce d’une maladie grave ne sera plus accueilli par une main tendue, mais pourra justifier une injection létale.
La fin de la médecine du soin : On passe d’une médecine qui soulage à une technique qui liquide. Si la « fatigue de vivre » devient un critère légal, c’est que notre société a renoncé à sa mission de fraternité.
L’abdication de l’esprit devant la matière
Pour cette vision réductionniste et matérialiste, le corps n’est plus le temple de l’esprit, mais une machine défaillante que l’on jette lorsqu’elle devient trop lourde à porter pour soi-même ou pour la collectivité. En niant l’âme, on réduit la dignité humaine à une simple équation d’utilité sociale. On préfère supprimer le souffrant plutôt que d’assumer le coût de l’amour, de la présence et des vrais soins palliatifs.
Ce que les députés préparent, sous les traits d’une loi qu’on ne peut qualifier que de scandaleuse, c’est l’abandon de toute verticalité. Les Français ne demandent pas qu’on les aide à mourir par désespoir, mais qu’on les aide à vivre jusqu’au bout. Ce texte est un dogme au service du vide, une rupture imposée d’en haut contre le bon sens et le respect de la vie reçue.
Redresser la tête face au cynisme
Malgré la stupeur de ce matin, il est temps de proclamer que nous ne sommes pas des machines biologiques. Notre grandeur réside dans notre aptitude à nous offrir mutuellement l’espérance, surtout quand l’angoisse se fait sombre. Le vrai bonheur n’est pas une sortie technique par décret, mais une rencontre humaine et spirituelle.
La France ne peut se résoudre à n’être qu’un laboratoire du néant. Face à ce matérialisme qui veut tout niveler, l’âme de notre pays doit se lever et affirmer que la vie, même blessée, même fatiguée, garde une valeur infinie que nulle loi inique ne pourra jamais effacer
Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.
“Celui qui ouvre béant le gouffre de la culture de mort finit par y être emporté, comme l’histoire l’a montré”
Homélie du Très Révérend Père Dom Jean Pateau, Abbé de Notre-Dame de Fontgombault, prononcée le 2 février 2026 en la fête de la Présentation de l’Enfant-Jésus au Temple :
Dimittis servum tuum… in pace. Tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix. (Lc 2,29)
Chers Frères et Sœurs, Mes très chers Fils,
Arrêtons-nous ce matin à la figure du saint vieillard Siméon. Comme le Baptiste, il se situe au point de rencontre entre l’Ancien et le Nouveau Testament. L’un et l’autre ont reçu des siècles passés l’héritage de la première alliance. Ils en sont comme les dépositaires. Mais à celle-ci succède dans le Christ une nouvelle alliance. Comme le Baptiste, Siméon doit accueillir le Seigneur et exercer sur lui comme un ministère. Pour le Baptiste, il s’agira de conférer le baptême dans l’eau. En Siméon, le charisme de prophétie se manifestera.
Qui est Siméon ? Saint Luc le présente comme : « Un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël. » (Lc 2,25) Cette attente est en réalité celle d’un peuple, le peuple d’Israël. Les siècles ont passé. La voix des prophètes s’est tue. Bien peu attendent désormais la venue du Messie promis. Chez Siméon pourtant, cette attente est demeurée vive. Il sait que cette attente sera la consolation de son peuple.
Et cette attente oriente sa vie. « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » (Mt 6,21) Aussi, « l’Esprit Saint était sur lui. » (Lc 2,25) Siméon vivait dans une vraie intimité avec Dieu. « Ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » (Rm 8,14)
Dépositaire de la promesse faite à Israël, Siméon est aussi dépositaire d’une promesse personnelle :
Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. (Lc 2,26)
Mais être dépositaire d’une promesse est une chose, savoir comment cette promesse va se réaliser et attendre paisiblement son accomplissement en est une autre.
Siméon demeure docile. Il se laisse conduire par Dieu, demeurant dans la paix et dans la joie. C’est ainsi que sous l’action de l’Esprit, il vint au Temple au moment même où les parents s’apprêtaient à présenter l’Enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi.
La scène est touchante. On imagine aisément le vieillard recevant des mains de ses jeunes parents l’Enfant Dieu dans ses bras. L’antienne de Magnificat des premières vêpres nous fait plonger dans le mystère :
Le vieillard portait l’Enfant, mais c’était l’Enfant qui conduisait le vieillard. Une Vierge l’a mis au monde, et après cette naissance, elle est demeurée Vierge ; Celui qu’elle a enfanté, elle l’a adoré.
À travers ces mots, on retrouve le mystère déjà évoqué dans l’office de la fête de Marie, Mère de Dieu :
O admirable échange ! Le Créateur du genre humain prenant un corps et une âme, a daigné naître d’une Vierge ; en entrant dans l’humanité sans le concours de l’homme, Il nous a donné part à sa divinité. (1ère antienne des Laudes du 1er janvier)
Cet admirable échange, Siméon en est l’heureux bénéficiaire. Les paroles prononcées alors par lui l’attestent. Elles constituent le troisième cantique tiré de l’Évangile que l’Église, dans l’office romain, a assigné à l’heure des Complies, et qui achève la journée par une note d’espérance :
Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. (Lc 2,29-32)
La lecture de l’Évangile de ce matin s’arrête là. Avant de s’éloigner, Siméon bénit la sainte famille et s’adressant à Marie, ajoute cette prophétie :
Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. (v. 34-35)
Le contraste est saisissant. Le vieillard, après avoir rencontré l’Enfant Jésus, part en paix tout en annonçant une guerre. Le glaive qui transpercera le cœur de Marie, transpercera aussi au long de l’histoire humaine le cœur des artisans de paix, des témoins de l’amour de Dieu pour les hommes. L’admirable échange offert à tout homme se heurtera au cœur dur et fermé des ennemis de Dieu.
Ceci demeure vrai alors que se déroule sous nos yeux, dans notre pays même, un épisode douloureux de cette « troisième guerre mondiale par morceaux », selon la formule du pape François.
Ici se dévoilent les pensées des cœurs, en particulier ce profond mépris pour l’être humain, pour sa vie qui devrait être respectée de son premier instant jusqu’à sa mort naturelle, pour la conscience de tant d’hommes et de femmes qui devrait être protégée par la loi dans des choix légitimes et qui les honorent.
À l’enfant dans le sein maternel, au vieillard sur le lit d’hôpital, l’Enfant-Dieu ouvre le chemin de cet admirable échange. Rendons grâces pour tant de congrégations religieuses, tant d’instituts qui, depuis des siècles, entourent les personnes âgées d’amour, les invitant à se préparer à la rencontre du Dieu des consolations. Il faut soutenir ces maisons de notre prière et de manière concrète. Bientôt une loi inique pourrait ne plus leur permettre de demeurer dans notre pays, devenu le lieu où s’exercerait un pouvoir totalitaire méprisant la conscience humaine, et le droit à respecter et accompagner la vie dans sa faiblesse.
Non, un pays ne se grandit pas en légalisant l’euthanasie ou l’avortement. Bien plus, il se déshonore. Non, il n’est pas sur un chemin de progrès. Celui qui ouvre béant le gouffre de la culture de mort finit par y être emporté, comme l’histoire l’a montré. Ajoutons qu’il est inadmissible et révoltant que des parlementaires s’arrogent le droit d’imposer à des établissements, à des professionnels de santé de concourir à de telles pratiques.
Au soir de son élection, le pape Léon a invité à vivre « une paix désarmée et désarmante ». Emboîtons le pas du vieillard Siméon qui s’éloigne en paix. Souhaitons cette paix aux hommes de notre temps, en particulier aux vieillards, une paix née de la rencontre avec le Christ. La lumière se lève. Espérance. Amen.
Préparer son coeur à la communion (épisode 21/23) – La messe, trésor de la foi
L’Agnus Dei
1 – Le « chant de la fraction »
D’origine orientale, le chant de l’Agnus Dei fut introduit dans la messe romaine au VIIe siècle pour accompagner le rite de la fraction. Il était « destiné à combler […] l’intervalle de silence résultant de l’accomplissement du rite »[1] qui, dans l’antiquité, tant qu’on ne faisait pas encore usage de pain azyme, ni de petites hosties, pouvait durer un certain temps.
Le chant Agnus Dei couvre désormais l’intervalle qui court de la fraction à la communion du prêtre[2] – et il s’inscrit opportunément entre ces deux rites, ainsi que nous allons le voir.
2 – Signification sacrificielle
Nous avons déjà eu l’occasion de mentionner que la fraction peut être regardée comme une évocation des souffrances du Seigneur. C’était déjà le cas en Orient au IVe siècle. Or, en Orient également, on désignait depuis fort longtemps les oblats eucharistiques sous le nom d’“agneau”, expression suggérée par maints passages de l’Écriture. L’agneau – l’agneau de Dieu – est en effet la figure par excellence du Christ-victime, du Christ offert et immolé en sacrifice :
– Ainsi, Isaac demandant à son père Abraham : « Où trouverons-nous l’agneau pour l’holocauste ? » Et Abraham répondant : « C’est Dieu qui pourvoira à l’agneau pour l’holocauste. »[3]
– Également le rite sacrificiel de la Pâque, initié à l’occasion de la sortie d’Égypte, où le sang de l’agneau répandu sur le linteau des portes préserve les Hébreux de l’ange exterminateur[4].
– Ou encore, la prophétie d’Isaïe, le chant du serviteur souffrant : « Maltraité, il s’humiliait, il n’ouvrait pas la bouche, comme l’agneau qui se laisse mener à l’abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette, il n’ouvrait pas la bouche. »[5]
– Il faut ajouter à cela l’agneau égorgé de l’Apocalypse[6].
– Enfin, saint Jean-Baptiste, qui désigne Notre-Seigneur à ses disciples par ces mots : « Voici l’agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. »[7]
D’où, en Orient d’abord, puis bientôt à Rome, ce chant de l’Agnus Dei célébrant, en particulier au moment de la fraction, l’agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. On comprend donc que :
[…] l’invocation à l’Agneau de Dieu s’adresse, non au Christ en général, mais au Christ en tant que victime du sacrifice dans l’eucharistie ; l’idée [sera la même à] l’instant de la communion, lorsque le prêtre [présentera] le Saint-Sacrement aux fidèles en disant : Ecce Agnus Dei. [Voici l’Agneau de Dieu]. »[8]
3 – L’invocation
Le texte lui-même du chant est donc emprunté au témoignage de saint Jean-Baptiste. Deux détails sont à mentionner.
Le premier semble purement grammatical : puisqu’il s’agit d’une invocation, le nom agnus – « agneau » en latin – devrait normalement être décliné en agne. Ainsi, nous disons fréquemment Domine, au lieu de Dominus, lorsque nous invoquons le Seigneur. Dans l’Agnus Dei, il n’en est rien. Ce fait semble répondre « à une loi grammaticale qui joue dans beaucoup de langues : un sentiment de respect tend à rendre indéclinables [certains] termes religieux »[9]. Il y a là une précieuse nuance que seul le latin nous permet de saisir.
Le deuxième détail est le passage au pluriel pour le terme « péchés » [peccata], qui est au singulier dans l’évangile [peccatum]. On trouvait déjà ce pluriel dans la prophétie d’Isaïe que nous avons mentionnée à l’instant : « Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Ipse autem vulneratus est propter iniquitates nostras adtritus est propter scelera nostra. »[10]
Comme l’explique saint Thomas : « Il est certain que le Christ est venu en ce monde pour effacer non seulement le péché qui s’est transmis par origine à la postérité, [c’est-à-dire le péché originel] mais encore tous les péchés qui s’y sont ajoutés par la suite. »[11] Il s’agit, certes, principalement du péché originel[12] – et c’est ainsi que l’on peut entendre le singulier de l’évangile[13] – mais il s’agit également de nos péchés personnels – et c’est ainsi que l’on peut entendre le pluriel de la liturgie.
4 – Les supplications
L’invocation Agnus Dei qui tollis peccata mundi est donc répétée à trois reprises, et suivie à chaque fois d’une supplication : Miserere nobis [« Ayez pitié de nous »] pour les deux premières ; Dona nobis pacem [« Donnez-nous la paix »] pour la dernière. Cette variante remonte au Xe siècle. Elle est une « conséquence probable du voisinage avec le baiser de paix »[14].
Le jeudi saint, en effet, où l’on ne donne pas la paix, on dit trois fois Miserere nobis [« Ayez pitié de nous »]. Aux messes des morts, la supplication vise plus directement les défunts : Dona eis requiem… [« Donnez-leur le repos… »], et l’on ajoute, la troisième fois : … sempiternam [« … éternel »].
5 – Les répétitions
L’Agnus Dei n’ayant plus à couvrir l’intervalle occupé par la fraction, il a fallu fixer le nombre de répétitions.
[…] peu à peu l’on s’arrêta au nombre sacré de trois répétitions […]. Ainsi naquit une hymne d’une extrême brièveté, mais d’une gravité puissante, qui, surtout dans le cadre où elle apparaît, peut se mesurer avec les hymnes de l’Apocalypse[15].
L’agneau qui est la victime de notre sacrifice et qui devient notre nourriture, en qui l’agneau pascal de l’Ancien Testament a trouvé sa réalisation suréminente, est l’agneau triomphant de l’universelle consommation, qui seul peut ouvrir le livre des destinées de l’humanité ; et si l’Église du ciel lui adresse les chants d’action de grâces des élus, vers lui montent aussi les supplications de la communauté des rachetés, qui poursuit son pèlerinage terrestre.
Ces perspectives se dégagent plus distinctes encore, si nous gardons présente à l’esprit l’évocation symbolique des souffrances et du triomphe du Seigneur, contenue dans la fraction et la commixtion[16].
Costa Rica : Victoire de Laura Fernández, une pro-vie élue présidente
Laura Fernández Delgado a été élue présidente de la République du Costa Rica avec 48,5 % des voix. Son parti, Pueblo Soberano, a remporté la majorité des sièges (31 sur 57). La candidate qui a offert le plus de garanties concernant la défense de la vie et de la famille a été élue.
Le 1er février, des élections présidentielles ont eu lieu au Costa Rica, avec une nette victoire de la droite conservatrice et l’élection de Laura Fernández Delgado, qui entrera en fonction le 8 mai 2026. Environ 3,7 millions de citoyens étaient inscrits sur les listes électorales pour élire le successeur du président sortant Rodrigo Chaves, les deux vice-présidents et les 57 membres de l’Assemblée législative.
Le gouvernement en place ne détenait que huit des 57 sièges au Congrès, ce qui avait freiné l’adoption de plusieurs de ses initiatives, mais le vote du 1er février a changé la donne.
Laura Fernández a remporté une victoire écrasante aux élections générales, et son parti est en passe d’obtenir la majorité au Congrès. Avec 48,5 % des voix, elle est devenue la 50e présidente de la République du Costa Rica. Le candidat du parti de la libération, Álvaro Ramos Chaves, a recueilli 33,3 % des suffrages. Le taux de participation s’est élevé à 70 %, tandis que l’abstention (30 %) est la plus faible enregistrée depuis l’élection présidentielle de 1998. Au Costa Rica, un candidat est élu dès le premier tour s’il obtient au moins 40 % des voix. Avec 48,5 % des suffrages lors des élections du 1er février 2026, Laura Fernández a donc franchi ce seuil, accédant à la présidence sans avoir à se présenter au second tour, initialement prévu le 5 avril.
Fernández gouvernera avec une majorité absolue de 31 sièges sur 57. Le Parti de libération nationale (centre) a remporté 17 sièges ; le Frente Amplio (gauche) n’en a obtenu que sept, tandis que la Coalition démocratique et le Parti chrétien-social (unité sociale) n’en auront chacun qu’un.
« Le changement sera profond et irréversible », a déclaré Fernández dans son discours de victoire, annonçant l’entrée du Costa Rica dans une nouvelle ère politique. Le pays que laisse derrière lui le président sortant Rodrigo Chaves bénéficie d’une « bonne gestion économique », avec des taux de chômage et de pauvreté en baisse, le chômage ayant chuté de 12 % à 6,9 % entre 2022 et juillet 2025. Cependant, l’un des principaux problèmes du Costa Rica aujourd’hui est l’insécurité de ses citoyens, car ces dernières années ont été marquées par une forte augmentation de la violence dans les rues du pays, généralement attribuée au trafic de drogue et au crime organisé.
Concernant les questions et principes non négociables, dans une interview accordée à EWTN le 28 janvier, le Dr Sadie Morgan a analysé les positions des principaux candidats sur la vie et la famille : Laura Fernández Delgado « s’est prononcée en faveur de la vie à plusieurs reprises » et a estimé possible de poursuivre plusieurs projets pro-vie et pro-famille lancés sous l’administration de Rodrigo Chaves. Elle a rappelé que, sous l’administration actuelle, les directives relatives à l’éducation sexuelle jugées « idéologiquement motivées » — c’est-à-dire favorables à l’idéologie du genre, à la contraception et à l’avortement — avaient été retirées, et l’utilisation du drapeau LGBT dans l’espace public avait été interdite. De plus, les conditions d’accès à l’avortement légal ont été durcies. Álvaro Ramos, le grand perdant, « n’a pas clairement affirmé sa position sur les questions pro-vie et pro-famille », tandis que Claudia Dobles a toujours été ouvertement « favorable à l’avortement ».
En octobre dernier, le président Rodrigo Chaves a abrogé le règlement technique en vigueur depuis 2019 relatif à la mise en œuvre de l’avortement dit thérapeutique et l’a remplacé par une nouvelle réglementation, réduisant ainsi la marge d’interprétation et protégeant la mère et l’enfant. Depuis lors, M. Chaves a réaffirmé que « l’avortement n’est possible sans sanction que lorsqu’il n’existe que deux options : le danger certain de mort pour la mère ou l’enfant », excluant de fait toute possibilité d’avortement en cas de problèmes de santé, même graves, chez la femme. Rien ne permet de penser que la présidente élue, Laura Fernández Delgado, renoncera à défendre et à promouvoir le droit à la vie, à la famille et à l’éducation, à l’instar des autres présidents d’Amérique centrale et du Sud élus ces derniers mois.
Une aide précieuse… pour une période riche !
Depuis dimanche, dans le calendrier liturgique de la forme tridentine du rite romain, l’Église est entré dans le temps de la Septuagésime, qui précédé le carême.
Sans bruit mais avec richesse, elle commence à nous conduire vers le mystère de la Passion.
Le Carême n’est pas d’abord une question de pratiques extérieures.
C’est un chemin intérieur, une lente préparation de l’âme à la Croix et au mystère de la Rédemption.
Mais ce chemin est exigeant.
Et trop souvent, faute de temps, de préparation ou de soutien,nous traversons ces semaines sans en goûter toute la richesse.
Une aide concrète pour vivre pleinement ce temps :
Pour accompagner ce temps de conversion, nous avons réuni, pour une durée très limitée, une sélection d’œuvres de référence du chant grégorien et de la liturgie de la Semaine Sainte.
Ces enregistrements vous aideront à :
– entrer plus profondément dans l’esprit propre du Carême,
– préparer les messes et les offices avec plus de recueillement,
– de vous laisser former intérieurement par le chant de l’Église,
– nourrir votre prière personnelle et communautaire.
Le chant grégorien ne cherche pas à impressionner.
Il apaise, éclaire, et oriente l’âme vers l’essentiel.
Une offre exceptionnelle… et brève
Cette sélection couvre tout le chemin liturgique :
– de la Septuagésime,
– au Carême,
– jusqu’aux Matines des Jours Saints et aux Offices des Ténèbres,
accompagnée du livre latin-français de la Semaine Sainte.
tri
L’offre « De la Septuagésime aux Jours Saints – Offre spéciale de Carême » est proposée avec une réduction globale de 30 %,
par rapport à l’achat des volumes séparément.
👉 Elle prendra fin le mercredi des Cendres, 18 février inclus.
Passé cette date, les produits retrouveront leur tarif habituel.
Si nous connaissions la juste valeur de la prière de l’Église,
nous nous empresserions d’en servir la beauté.
Ne laissons pas ce temps de grâce passer sans y entrer pleinement.
👉 Découvrir l’offre spéciale à durée limitée :
https://www.musique-liturgique.com/offre-carême-2026
L’équipe de Sacra Musica
Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.
L’importance de la lecture
A l’occasion de la sortie de son ouvrage sur La Lecture en question, nous avons interrogé Jean-Pierre Maugendre, ancien élève de l’École navale, ancien président du Mouvement de la Jeunesse Catholique de France, directeur de Renaissance catholique et co-animaneeur de l’émission Terres de Mission sur TV Libertés.
Vous publiez un livre pour inciter à lire. Ne craignez-vous pas de ne prêcher qu’à des convaincus ?
Effectivement ce risque existe, c’est pour cela qu’avec mon éditeur nous avons fait le choix d’un livre de taille réduite qui se lit en 1h30. Nous nous sommes, de plus, attachés à un plan clair qui nous semble susceptible de susciter l’intérêt des lecteurs même occasionnels:
A la fin de votre ouvrage, vous proposez une petite bibliothèque de base dans laquelle il n’y a aucun roman. Pourquoi ce choix ?
Cette bibliothèque de base, composée de 11 rubriques: apologétique, spiritualité, doctrine, philosophie, politique, éducation-famille, etc., ne contient effectivement pas de rubrique romans. La raison en est que le sujet des romans est abordé dans la partie: Lectures de détente. Ces lectures sont, par nature très personnelles. Sont ainsi mis en valeur quelques romanciers célèbres contemporains: Eugenio Corti (Le cheval rouge), Mickael O’Brien (Père Elijah), Jean Raspail (Le camp des saints) ou plus anciens: Jean de La Varende (Les manants du roi) ou Vladimir Volkoff ( Le montage).
Vous dites que la lecture est en crise et pourtant 436 millions de livres sont vendus chaque année en France, 78000 nouveaux titres sont versés à la BNF chaque année, ce qui fait environ 200 nouveaux livres chaque jour. La lecture est-elle réellement en crise ?
La lecture est en crise parce que en moyenne le temps consacré, par chacun, à la lecture diminue. Les Français consacrent à la lecture le même temps, par semaine- 3h40- qu’ils consacrent aux écrans par jour- 3h21- Quant aux ventes de livres, parmi les 200 nouveaux livres parus chaque jour 90% ne seront pas vendus à plus de 500 exemplaires. Il suffit d’observer une rame de métro ou un wagon de train pour observer que la lecture d’un livre est devenue une originalité.
Arnaque à la solidarité
L’abbaye de La Lucerne alerte sur une arnaque circulant à son sujet :
Avez-vous les deux « Kervizic » indispensables pour le carême : Mon petit livre de carême et Ma Semaine Sainte ? C’est sur LIVRES EN FAMILLE
Voilà une collection qui rencontre un très grand succès mérité.
DEUX OUVRAGES INDISPENSABLES POUR LE CARÊME :
– Le Carême, qui accompagne les enfants jour après jour, du Mercredi des cendres au Lundi de Pâques.
– La Semaine Sainte, pour bien vivre ces Grands Jours avec la Passion illustrée et le Chemin de Croix
Déjà des milliers de petites mains ont tourné les pages de ces album ravissants. Dessins clairs, frais, illustrant à merveille des vies de saints, des anecdotes véridiques. Un texte aéré, des mots choisis pour accompagner l’enfant et lui faire lever les yeux vers le ciel. Un format à l’italienne permet une lecture partagée et animée en découvrant ces dessins fourmillants de détails.
CE SONT TOUJOURS DES HISTOIRES VRAIES
A la fin de chaque histoire, une parole, un rappel de la fête du saint du jour, ou une courte prière, parfois une strophe d’un cantique, ou un exemple d’effort à faire, de sacrifice, de prière. En regard de chaque texte, un dessin en pleine page, illustre le propos. Comment ne pas être captivé par “l’histoire d’un chapelet”, ou bien celle des petits souliers rouges de sainte Véronique Giuliani, lorsqu’elle était enfant, et les miracles du Saint-Sacrement exposé, ou lorsqu’une Hostie consacrée fut oubliée dans un tiroir, l’action miraculeuse d’un scapulaire, l’histoire de sainte Anne d’Auray, de Notre-Dame du Liban…et tant d’autres récits qui feront vibrer les âmes des jeunes lecteurs, les entrainant à la suite de ces modèles ordinaires et extraordinaires !
Aurélie Kervizic a mis son talent merveilleux d’écrivain et de dessinatrice au service des plus jeunes, pour les aider à vivre sous le regard du Bon Dieu. Et quand la plume et le pinceau s’allient pour un tel idéal, c’est enchantement pour le cœur et l’âme. Pas seulement pour les plus jeunes, mais aussi pour les parents, les grands-parents réquisitionnés pour la lecture.
SONT PARUS :
– Mon petit Jésus, pour le mois de janvier,
– Le petit livre de l’été, juillet, de belles histoires pour penser au Bon Dieu pendant les vacances…
– Le petit livre de l’été, 31 nouvelles histoires pour penser au Bon Dieu pendant le mois d’août…
– Mon Meilleur Ami, septembre jour après jour avec les Anges
– Mes amies les âmes, novembre avec les âmes du purgatoire
– Mon petit livre de Noël, véritable calendrier de l’Avent : 26 histoires – 51 dessins pour cheminer jusqu’à Noël… Et une préparation excellente pour la Première Communion.
RETROUVEZ TOUS LES TITRES D’AURELIE KERVIZIC SUR LIVRES EN FAMILLE
https://www.livresenfamille.fr/3077_aurelie-kervizic
Vous pourrez y découvrir les illustrations de chaque ouvrage , les sommaires, les recensions et avis des lecteurs.
Albums en belle édition reliée, format à l’italienne, 100 pages, Editions Maélic, 17€.
Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.
Carême 2026 : 40 jours de méditation biblique avec l’apôtre Paul
Communiqué de Meditatio :
A partir du 18 février, l’application de méditation chrétienne Meditatio propose à ses utilisateurs de se mettre en route vers Pâques avec l’apôtre Paul. Pendant 40 jours, chacun est invité à méditer les lettres du disciple en pratiquant la lectio divina, une manière très ancienne de prier avec les textes de la Bible.
Rédigées entre les années 50 et 60 après Jésus-Christ, les lettres de saint Paul sont les écrits chrétiens les plus anciens, antérieurs aux Évangiles. Ces lettres sont d’une importance capitale pour les chrétiens puisqu’elles offrent le témoignage le plus ancien qui existe sur le Christ et sont animées d’une foi vive, marquée par l’urgence, l’espérance et la foi missionnaire. Deux mille ans plus tard, ces textes demeurent d’une étonnante actualité et continuent d’éclairer la vie spirituelle des chrétiens.
Concrètement, Meditatio proposera chaque semaine de s’arrêter sur une lettre spécifique adressée à une communauté chrétienne ou à un disciple et de méditer les paroles de l’apôtre Paul en pratiquant la lectio divina.
A partir du mercredi 18 février, l’utilisateur sera invité chaque jour à suivre une session audio de 10 ou 15 minutes (au choix), centrée sur un extrait d’une des lettres de Paul. Dans chaque séance, il lui sera proposé d’écouter attentivement un passage biblique puis de le méditer en profondeur avant d’y répondre par la prière puis de demeurer quelques instants en présence de Dieu dans le silence. Ce parcours est constitué de 40 séances et s’achèvera le dimanche 5 avril, jour de Pâques.
S’appuyant sur plus de 2000 ans de tradition chrétienne, Meditatio est une application qui propose des méditations audio accessibles à tous pour apprendre à méditer au quotidien et développer une intimité avec Dieu. Avec plus de 500 000 téléchargements, elle s’adresse à tous les Chrétiens où qu’ils en soient dans leur vie, avec des parcours variés : cultiver la gratitude, gérer son stress, pratiquer l’oraison, s’endormir paisiblement, découvrir la méditation ignatienne, écouter les signes de Dieu, trouver la paix…
Avec ce nouveau parcours de Carême, Meditatio offre à chacun la possibilité de prendre quelques minutes chaque jour pour rencontrer personnellement Dieu et faire grandir sa vie
intérieure.
L’application est disponible sur iOS et Android.
En Belgique, les croque-mort, pardon…, les mutuelles, vantent l’euthanasie dans les maisons de retraite
Pierre Jova, journaliste à La Vie, a enquêté sur l’euthanasie en Belgique. Extrait : croque-mort
Prétendre que cela ne va « forcer personne », c’est faire fi, encore une fois, des dynamiques de la société et de l’aliénation dont nous pouvons être victimes. La loi envoie un message. La loi est normative, et même performative. La Belgique le prouve. Au départ, les euthanasies restaient parcimonieuses. Nous sommes passés de 235 en 2003 à près de 4000 en 2024. Toute personne est en mesure de l’envisager. Des gens qui ne l’auraient pas voulu, qui ne l’auraient pas demandé, se retrouvent à le faire. La loi créé sa propre dynamique, et une véritable promotion se met en place : qui sait qu’en Belgique, les grandes mutuelles visitent les maisons de retraite pour vanter les mérites de l’euthanasie aux personnes âgées ?
Chronique de la censure, suite
Le chanteur Bénabar a critiqué France Inter, accusant la radio publique de jouer un rôle de censeur culturel, lors d’une récente interview dans l’émission “Le Figaro la nuit”.
“Télérama, France Inter, ce sont des censeurs”. “Il faut éviter les gens qui décident ce qui est bien, ce qui n’est pas bien. Parce que c’est ça la censure en fait. Alors que la chanson populaire, c’est justement le public qui décide”.
Bénabar dénonce également une ligne éditoriale prescriptive, estimant que certaines radios publiques orientent les goûts des auditeurs au détriment d’une diversité musicale plus large.
“Il y a trois quarts des artistes français qui ne renvoient même pas leur disque à France Inter. Et c’est le service public, donc ça pose un problème”.
Ce week-end, France Inter s’est retrouvée au cœur d’une nouvelle polémique après la diffusion d’une chronique humoristique jugée choquante par une partie des auditeurs. Lors de cette séquence, une humoriste, vêtue d’un costume d’époque, a improvisé une chanson évoquant la mort de Jordan Bardella et Marion Maréchal, qui auraient été emportés par une variole mortelle.
CEDH : après l’affaire des crucifix dans les écoles italiennes, celle des icônes dans les tribunaux grecs
La Cour européenne des droits de l’Homme a demandé à la Grèce de justifier la présence d’icônes orthodoxes dans ses tribunaux. Nicolas Bauer, expert au Centre européen pour le droit et la justice, Nicolas Bauer intervient à ce titre devant la CEDH. Il explique dans Le Figaro :
En 2009, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) avait rendu un jugement fracassant, qui enjoignait à l’Italie de retirer les crucifix présents dans ses écoles. Vingt et un gouvernements européens s’y étaient opposés, car ils refusaient que la jurisprudence européenne impose ainsi la suppression des symboles religieux figurant dans les bâtiments publics. Face à cette mobilisation inédite, la CEDH avait réexaminé l’affaire et était parvenue, en 2011, à une conclusion opposée : il était légitime que l’Italie « perpétue une tradition ». C’était l’affaire Lautsi contre Italie.
Quinze ans après, la CEDH a demandé à la Grèce de se justifier sur la présence d’icônes orthodoxes sur les murs de ses tribunaux. Le mémoire du gouvernement grec est attendu pour le 19 février 2026, avant que la CEDH ne rende son jugement. Après l’affaire des crucifix, cette nouvelle « affaire des icônes » rouvre un débat qui semblait clos. Les symboles chrétiens encore visibles dans les bâtiments publics doivent-ils être retirés, au nom de la « neutralité religieuse » ? Ces symboles portent-ils atteinte à la liberté des citoyens « de ne pas adhérer à une religion » ?
Les juges européens procèdent à l’examen d’environ 5 % des recours qui leur sont soumis, opérant ainsi une forte sélection, et aucun des nombreux recours contre les symboles chrétiens dans les bâtiments publics n’avait été retenu depuis Lautsi contre Italie. La CEDH s’est délibérément saisie de cette affaire des icônes, en exhumant une requête déposée en 2020, ce qui satisfait les juges qui demandaient publiquement une révision des principes posés dans Lautsi. Ces éléments montrent que la CEDH pourrait obliger la Grèce à décrocher les icônes présentes dans ses bâtiments publics.
La CEDH décrit elle-même sa jurisprudence comme « vivante, dynamique et évolutive ». Pour autant, il serait dommageable de considérer que la jurisprudence Lautsi de 2011 est périmée. Ce jugement avait le mérite de respecter les traditions culturelles nationales, y compris dans leur dimension religieuse. La CEDH avait considéré qu’un crucifix dans une salle de classe italienne correspondait à un symbole religieux « essentiellement passif », dans la mesure où « on ne saurait notamment lui attribuer une influence sur les élèves comparable à celle que peut avoir un discours didactique ou la participation à des activités religieuses ». Les crucifix étaient ainsi distingués d’autres symboles religieux, comme le voile islamique, qualifié de « signe extérieur fort » ayant un « effet prosélyte ».
La CEDH avait par ailleurs accepté que l’Italie « donne à la religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante ». Cette question culturelle relevait de la « marge d’appréciation de l’État », c’est-à-dire de sa souveraineté. Jusqu’à présent, la CEDH a toujours expliqué qu’elle n’imposait aucune obligation aux États qui serait « susceptible de diminuer le rôle d’une foi ou d’une Église auxquelles adhère historiquement et culturellement la population ». Elle n’a jamais condamné non plus l’existence d’une religion officielle dans certains États européens.
De fait, la Grèce est un État officiellement orthodoxe et a souhaité maintenir cette confessionnalité de l’État lors de la dernière révision de sa Constitution en 2019. La présence d’icônes orthodoxes dans les bâtiments publics est une coutume grecque, découlant directement de cette Constitution. Celle-ci énonce que « la religion dominante en Grèce est celle de l’Église orthodoxe orientale du Christ » et reconnaît comme « chef spirituel suprême Notre Seigneur Jésus-Christ ». Ces dispositions relèvent de l’identité constitutionnelle grecque. D’autres États européens ont une identité constitutionnelle religieuse, comme le Danemark (évangélique luthérien) ou Monaco (catholique).
L’identité constitutionnelle correspond à l’« être » de l’État et non à son « agir », selon une distinction élaborée par la doctrine juridique. Or, le rôle de la CEDH devrait se limiter à juger de l’agir de l’État, car la garantie des libertés individuelles relève de l’action de l’État et non de son identité. En pratique, les gouvernements les plus condamnés par la CEDH, y compris en matière de liberté de religion, sont ceux d’États laïques. Si les juges européens doivent s’abstenir de statuer sur l’identité constitutionnelle d’un État, c’est aussi que celle-ci est souvent indissociable d’une identité nationale et culturelle.
Certes, la séparation entre l’être et l’agir de l’État peut paraître artificielle. Mais elle permet de limiter sainement le rôle de la CEDH, en respectant la souveraineté des États européens. Obliger la Grèce à décrocher les icônes des murs de ses tribunaux n’apporterait rien aux libertés individuelles, mais serait une perte sur le plan civilisationnel. Ce serait un triste symbole, alors même que l’Europe fait face à une augmentation des actes antichrétiens. Il faut espérer que la CEDH ne participera pas à cet iconoclasme.
Chronique de la censure
La Ligue des droits de l’Homme se réjouit de la perquisition des locaux français de la plateforme X (anciennement Twitter) dans le cadre de l’enquête ouverte par le parquet de Paris sur le fonctionnement de ses algorithmes et de l’intelligence artificielle Grok.
La LDH, engagée au sein du collectif Escape X, est à l’origine d’une plainte adressée au parquet de Paris pour contestation de crime contre l’humanité et négationnisme en lien avec une publication de Grok.
Le parquet convoque Elon Musk en “audition libre” le 20 avril.
Pavel Dourov, fondateur du réseau Telegram, ayant déjà fait de la garde à vue en France souligne :
« La police française est actuellement en train de perquisitionner les bureaux de X à Paris. La France est le seul pays au monde qui persécute pénalement tous les réseaux sociaux qui accordent aux gens un certain degré de liberté (Telegram, X, TikTok…). Ne vous méprenez pas : ce n’est pas un pays libre. »
Réaction de la direction de X :
« Les autorités judiciaires françaises ont perquisitionné ce jour les bureaux parisiens de X dans le cadre d’une enquête pénale reposant sur des motivations politiques et faisant suite à des allégations de manipulation d’algorithmes et de prétendues extractions frauduleuses de données. Nous sommes déçus par ce développement mais il ne nous surprend pas. Le parquet de Paris a donné un large écho médiatique à cette mesure, démontrant ainsi qu’elle constitue un acte judiciaire abusif visant à atteindre des objectifs politiques illégitimes plutôt qu’à favoriser la plus juste application de la loi dans le respect d’une administration loyale et impartiale de la justice.
Le parquet de Paris tente manifestement d’exercer une pression sur la direction générale de X aux Etats-Unis en visant notre entité française, étrangère aux faits poursuivis, ainsi que ses employés, au mépris des mécanismes procéduraux établis par les traités internationaux leur permettant de collecter des preuves ainsi que du droit de X de se défendre. Ces mécanismes et véhicules procéduraux sont parfaitement connus et utilisés quotidiennement par les autorités judiciaires du monde entier.
Les allégations ayant justifié cette perquisition sont infondées et X réfute catégoriquement avoir commis la moindre infraction. Cette mise en scène ne fait que renforcer sa conviction que cette enquête viole le droit français, constitue un détournement de procédure et porte atteinte à la liberté d’expression. X est déterminée à défendre ses droits fondamentaux ainsi que ceux de ses utilisateurs. Nous ne nous laisserons pas intimider par les mesures mises en œuvre aujourd’hui par les autorités judiciaires françaises. »
Les contacts se poursuivent entre Rome et la FSSPX
Répondant aux questions des journalistes, le directeur de la Salle de presse du Saint-Siège a souligné qu’après l’annonce de plusieurs ordinations épiscopales en juillet, les discussions entre les parties se poursuivent. Son propos, bref, tranche avec
«Les contacts entre la Fraternité Saint-Pie X et le Saint-Siège se poursuivent, l’objectif étant d’éviter toute rupture ou solution unilatérale concernant les problèmes soulevés».
C’est ce qu’a déclaré Matteo Bruni, directeur de la Salle de presse du Saint-Siège.
Dans le communiqué de la Fraternité Saint-Pie X, il est fait référence à une lettre envoyée au Saint-Siège dans laquelle était exprimée «la nécessité particulière pour la Fraternité d’assurer la continuité du ministère de ses évêques». Le Saint-Siège – peut-on lire dans le communiqué – a envoyé «une lettre qui ne répond en aucune façon à nos demandes», d’où la décision de poursuivre dans la voie indiquée.
Sur X, la journaliste américaine accréditée auprès du Saint-Siège, commentait l’annonce de la FSSPX en évoquant le cas chinois :
Depuis l’accord provisoire Vatican-Pékin de 2018, les autorités chinoises ont parfois annoncé la nomination d’évêques et leur consécration sans mandat papal préalable, même durant le récent interrègne pontifical. Cependant, Rome a par la suite cédé et accepté ces nominations.
L’association des Juristes pour l’enfance plaide devant la CEDH la fin de la congélation des embryons
Communiqué :
Juristes pour l’enfance dépose ce jour devant la Cour européenne des droits de l’homme une tierce intervention (Amicus Curiae) dans l’affaire Ngoma c. France (requête n° 29584/24, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-245115), pour défendre l’intérêt supérieur de l’enfant.
Juristes pour l’enfance démontre de quelle manière la congélation et la conservation des embryons est contraire à l’intérêt et aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle permet la survenance de situations inextricables, notamment lorsque le père décède. En effet, dans ce cas :
– soit l’embryon est implanté chez sa mère (ce que demande la requérante) et alors il naîtra orphelin de père ;
– soit l’embryon est accueilli par un autre couple ou par une femme seule (ce que permet la loi française) et alors il est privé de sa mère qui souhaite pourtant le porter et le mettre au monde.
C’est la congélation et la conservation des embryons qui rend possible le décès du père avant leur implantation. Il suffirait de conserver uniquement les gamètes, et de ne concevoir les embryons qu’au fur et à mesure de leur implantation, pour éviter la survenance de ces situations inextricables.
Par conséquent, Juristes pour l’enfance demande à la Cour d’enjoindre à la France d’interdire la congélation des embryons et de lui substituer la seule congélation des gamètes, seule solution respectueuse de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Loi sur la fin de vie : où en sont les discussions, et comment agir ?
Communiqué de la Marche pour la vie :
Il y a quelques jours, le Sénat a proposé un nouveau texte de loi sur la fin de vie, effaçant l’acte létal et donc la substance de “l’aide à mourir”. Suite à un vote, ce texte n’a pas été adopté. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Malheureusement, c’est plutôt une mauvaise nouvelle. En effet, c’est donc son propre texte que l’Assemblée va reprendre, or voici ce que contenait ce texte :
Loi votée à l’Assemblée nationale le 27 mai 2025
1) L’aide à mourir définie comme un soin et un droit
- Modification du code de la santé : l’euthanasie et le suicide assisté sont intégrés dans le “droit d’avoir une fin de vie digne”.
- Prescription, et administration si nécessaire, de la substance létale par un soignant.
2) Conditions d’accès floues et larges
- Selon ces conditions soi-disant strictes, il y aurait aujourd’hui 1 million d’éligibles.
- Cela ne concerne pas seulement les patients en fin de vie (possibilité de choisir une date dans + d’1 an).
- L’évaluation d’éligibilité est à la libre détermination du pouvoir médical.
- Pas d’obligation de référer le patient vers un psychologue ou un psychiatre.
3) Une procédure rapide et facile
- Le patient a un délai de réflexion de 2 jours.
- Pas de réelle collégialité, la décision est prise par le médecin sous 15 jours.
- Pas de recours possible de la part des proches (sauf pour le tuteur d’un majeur protégé).
- Commission de contrôle a posteriori : la commission n’examine la validité du dossier qu’après le décès.
4) Délit d’entrave à l’aide à mourir
- Interdiction de dissuader une personne d’une euthanasie ou suicide assisté — y compris pour les psychologues, psychiatres et représentants religieux — sous peine de 15 000 € d’amende et 1 an de prison.
5) Clause de conscience réduite
- Pas de clause de conscience pour les pharmaciens.
- Tous les établissements devront permettre une offre d’”aide à mourir”.
Les débats seront de retour dans l’hémicycle de l’Assemblée la semaine du 16 février. D’ici là, il est urgent d’agir !
Comment agir concrètement ?
Pour avoir une influence directe, la meilleure solution est de rencontrer votre député. Certains députés sont réellement à l’écoute et votre témoignage peut les éclairer sur cette question qui n’est pas évidente. Si cela n’est pas possible, nous vous invitons à lui écrire :
Vous pouvez également aider financièrement la Marche pour la vie qui se mobilise toute l’année pour faire valoir les soins palliatifs plutôt que le suicide assisté ! Concrètement, nous avons besoin de votre aide pour équilibrer le déficit de 20.000€ suite à la Marche de cette année, et pouvoir continuer à agir dans le débat public, au moment où la question de la fin de vie revient devant les députés.
Un don, quel qu’en soit le montant, est un acte concret pour défendre les plus fragiles, ceux que la société veut délaisser !
Toujours plus de censure !
De Guillaume de Thieulloy dans Les 4 Vérités :
Ce mois de janvier 2026 pourra être marqué d’une pierre noire dans les annales des libertés publiques. La principale mesure a été l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Cette mesure a toutes les apparences d’une bonne idée. Il est évident que passer 5 ou 6 heures par jour à « zapper » des vidéos plus ou moins addictives détruit les facultés cognitives des adolescents – sans parler des innombrables occasions de harcèlement ou même des incitations au suicide.
Mais j’imagine que ces enfants ont des parents. Je ne vois pas du tout pourquoi l’État s’immisce dans leur éducation – si ce n’est pour justifier son sobriquet de « Big Mother ». Je crois donc que cette mesure détruit encore un peu l’autorité parentale; ne servira à rien (on voit mal comment l’État réussirait là où les parents échouent); et, surtout, crée un dangereux précédent. Car, pour rendre cette interdiction efficace, il va bien falloir contrôler l’âge. « On » nous assure que cela n’aura rien à voir avec du « flicage ». Voire. Nous avons désormais quelques décennies de recul pour apprécier la valeur de telles promesses. D’autant que, parmi les solutions « sûres » qui sont actuellement évoquées, il est question de l’utilisation d’un « tiers de confiance »… qui pourrait être l’État lui-même!
Pour mesurer à quel point la parole de l’État est fiable en matière de libertés publiques, rappelons que la vidéosurveillance algorithmique avait été autorisée à titre expérimental pour les JO de 2024. Or, une loi actuellement en discussion envisage la prolongation de « l’expérience » jusqu’en 2027 – et le site La Quadrature du Net, qui suit de près les questions liées aux libertés numériques, nous indique que l’objectif du gouvernement est d’obtenir une « expérimentation » jusqu’en 2030, pour les prochains Jeux olympiques. Autant réclamer tout de suite la légalisation définitive du processus, ce sera plus simple!
Pour revenir à l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, comment douter qu’elle permettra, à terme, à l’État de décider qui peut accéder ou non aux-dits réseaux ? Naturellement, à la veille d’échéances électorales importantes, un tel pouvoir n’a rien d’anodin. D’autant que les mesures de censure extra-judiciaires ne sont déjà pas rares. Beaucoup ont commenté les sanctions de l’UE contre le franco-russe Xavier Moreau en parlant du fond de ses propos. Mais on peut à la fois être en désaccord avec les propos de ce dernier sur la guerre en Ukraine et s’inquiéter qu’il soit possible, sans procédure judiciaire (et sans déclaration de guerre à la Russie!), de couper à un citoyen français l’accès à ses comptes bancaires. Le principe de base en matière de liberté est: Hodie mihi, cras tibi. Si l’on accepte tranquillement que des personnes soient ainsi censurées, qui nous soutiendra si notre tour arrive dans quelques années ? Désormais, le gouvernement envisage l’interdiction des VPN (comme la Corée du Nord ou la Chine, modèles bien connus de liberté!). Certes, il est douteux que cela soit techniquement possible. Mais le simple fait d’y songer en dit long sur la détestation d’Emmanuel Macron et des siens pour les libertés publiques – et pour la liberté d’expression sur internet plus particulièrement. Il serait temps que l’opposition se réveille, avant d’avoir été totalement réduite au silence. Mais, pour le moment, à l’exception notable de LFI, elle se contente, au contraire, de réclamer du gouvernement toujours plus de censure!
Emmanuel Macron vu par Brigitte : Tchao Manu
«Quand tu liras cette lettre, j’aurai quitté l’Élysée et tourné à tout jamais le dos aux murs feutrés qui abritaient, depuis notre arrivée au Palais, le drame bourgeois nous tenant lieu de quotidien. A 72 ans, je n’ai plus envie de jouer les maitresses d’école. Je ne suis plus ton professeur de théâtre, tu n’es plus mon élève chéri. »
Depuis sa quinzième année, elle ne l’a plus quitté. Elle l’a d’abord initié à la comédie, puis l’a assisté dans sa quête du pouvoir, financier et politique, avant de l’accompagner à l’Élysée. Pour avoir partagé pendant 33 ans sa vie, elle est celle qui le connait le mieux, de sa part d’ombre à ses brillantes fulgurances. Au moment où 2 Français sur 3 souhaitent le départ du Président de la République, Tchao Manu emprunte, dans cette lettre-fiction, la plume mordante de la Première Dame pour dresser un bilan accablant de 8 années de macronisme. TCHAO MANU est une lettre-fiction de plus de 100 pages, signée Aphrodite, qui agace l’Élysée. Elle quitte l’Élysée et s’en explique…
Tout y passe : son ego démesuré, son narcissisme surdimensionné, son mépris de la France et des Français, sa déloyauté, son absence de convictions et de vision politique, ses amitiés délétères et ses reniements. Après l’avoir adulé, elle a décidé, à son tour, de le rayer de son existence et elle nous dit, avec une férocité toute féminine, pourquoi.
Mais quel auteur impertinent se cache derrière le pseudonyme d’Aphrodite, la déesse grecque de l’amour ? Une romancière de talent ? Un politique blessé par la désinvolture manifestée à son égard par Emmanuel Macron ? Une journaliste facétieuse ? Peu importe la réponse. L’important est que cette petite pochade politique sonne juste et donne à s’amuser.
L’auteur revisite les deux quinquennats catastrophiques de Macron, agrémenté de citations toutes authentiques. En voici un extrait sur l’avortement :
Mais derrière ce comportement exemplaire et tes déclarations de façade, il y a toujours eu chez toi une profonde aversion pour le modèle familial naturel fait « d’un papa et d’une maman » comme le scandaient, à pleins poumons, en 2010, dans les rues de Paris, des centaines de milliers de marcheurs de la Manif pour tous. Pour toi, cette famille traditionnelle, parfaitement obsolète, est un concept désuet, une résurgence anachronique d’un passé à effacer. Place désormais aux nouvelles formes de parentalité – famille recomposée, mariage homosexuel, monoparentalité, PMA ; des changements de paradigmes dont tu t’es fait le défenseur acharné. […]
Au moment de désigner dans le gouvernement Attal une Ministre de (ou des) Famille(s) – son titre a fluctué avec les vents dominants –, tu as choisi Sarah El Hairy, la députée Modem de Loire–Atlantique connue, avant tout, pour son homosexualité et son recours à la PMA pour devenir mère, et retoqué – pour lui succéder – en raison de « son profil conservateur », Laurence Garnier, la sénatrice du même département qui , à contrario, s’est toujours opposée, par convictions personnelles au mariage homosexuel, à l’interdiction des traitements de conversion et à l’inscription dans la Constitution du droit l’avortement. A l’heure de se justifier, il est vrai qu’elle s’en est tirée par une pirouette : « Nos concitoyens attendent du gouvernement qu’il s’occupe de redresser notre pays, plutôt que de problèmes qui n’existent pas ».
Ce sont ces mêmes calculs électoraux – au moment où tes électeurs de gauche défilaient dans la rue pour dénoncer ta désastreuse réforme des retraites – qui t’ont conduit à faire inscrire dans la Constitution « le droit à l’avortement ». Aucune menace véritable ne pèse, en France, sur ce droit intime, entré dans les mœurs et auquel personne ne s’oppose ; à commencer par Marine Le Pen qui y a toujours été favorable. Comme l’a souligné Gérard Larcher, le Président du Sénat dont on ne peut mettre en doute son attachement aux libertés fondamentales, tu as été déterrer un péril inexistant en vue d’amadouer socialistes et féministes : « L’IVG n’est pas menacée dans notre pays. Si elle était menacée, croyez–moi, je me battrais pour qu’elle soit maintenue. Mais je pense que la Constitution n’est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux (…) La première préoccupation qui est la mienne, c’est les conditions dans lesquelles on pratique l’interruption volontaire de grossesse », avant de rappeler « la fermeture, en plus de dix ans, de 130 centres consacrés à l’IVG ». Pour avoir vécu trente ans à tes côtés, je connais tes convictions, tes motivations et tes manipulations. Une fois encore, tu as ressorti de ton « sac à malices » le péril de l’extrême droite haineuse qui menacerait la liberté d’avorter, en espérant avec cette manœuvre grossière te réconcilier avec ton électorat de gauche. Il est vrai que tu lui dois beaucoup : par peur de la « bête immonde », il t’a élu deux fois, avant de te honnir car il ne supportait plus ton arrogance, ton nombrilisme, tes trahisons à répétition et tes tergiversations libérales. Dans ce monde planétaire uniforme où ne nous sommes plus que des avatars anonymes égarés dans le magma de réseaux sociaux, le petit village (ou le quartier) qui nous a vu naitre reste notre dernier refuge avec son église, sa mairie, son école, sa gendarmerie, sa poste et sa maternité, son bon docteur et son vétérinaire bougon, son centre–ville avec ses rues commerçantes.
L’effacement de la femme par la gestation pour autrui (GPA) et l’idéologie du genre
Le 30 janvier dernier à Paris, Aude Mirkovic, présidente des Juristes pour l’enfance, est intervenue lors de l’évènement organisé par Boulevard Voltaire, autour du thème : « Urgence Françaises en danger » :
Une élève pro-vie fait appel devant la Cour suprême après l’interdiction des affiches de son club dans son lycée
Un étudiant et un groupe pro-vie de l’Indiana font appel devant la Cour suprême des États-Unis après qu’un tribunal inférieur a statué que le lycée de Noblesville pouvait interdire l’affichage de publicités de clubs pro-vie sur les murs de l’école.
Les tracts en question, créés par Students for Life of America (SFLA), portaient le titre « Étudiants pro-vie, il est temps de se réunir ! » et des images de jeunes manifestants tenant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Supprimez le financement de Planned Parenthood » et « Je suis la génération pro-vie ».
L’élève, à qui l’autorisation d’afficher les tracts a été refusée, avait déjà obtenu l’agrément de son établissement pour son club et comptait plus de 30 membres. Non seulement l’école a interdit l’affichage de ces tracts, mais elle a également suspendu son club après que l’élève et sa mère ont continué à faire appel de cette décision, que le principal a qualifiée de « tentative d’insubordination menée par un adulte extérieur prenant parti pour l’élève ». Elle a ensuite été autorisée à postuler à nouveau et le statut du club a été rétabli, mais l’élève et ses parents ont intenté un procès, arguant que la censure et la suspension étaient motivées par « l’hostilité envers ses opinions pro-vie, en violation du Premier Amendement et de la Loi sur l’égalité d’accès ».
En août dernier, cependant, la Cour d’appel du septième circuit a statué contre l’étudiant, déclarant que le lycée était dans son droit de refuser les tracts, car ils contenaient un contenu « politique » non neutre susceptible de « perturber » et pouvaient « raisonnablement être perçus comme portant l’approbation de l’école ».
Le 28 janvier, Alliance Defending Freedom (ADF) a annoncé qu’elle faisait appel de l’affaire devant la Cour suprême des États-Unis au nom de l’élève et de Noblesville Students for Life. L’ADF souligne qu’« aucune politique écrite ne régit » le contenu des tracts que les « plus de 70 clubs parascolaires » du lycée sont autorisés à afficher dans les espaces communs de l’établissement. La pétition dénonce une « discrimination fondée sur les opinions ».
John Bursch, conseiller principal et vice-président du contentieux d’appel de l’ADF, explique :
« Les élèves ne perdent pas leur liberté d’expression, protégée par la Constitution, lorsqu’ils entrent dans un établissement scolaire. Une école ne peut interdire à un lycéen ou à une association étudiante d’exprimer publiquement des messages pro-vie qui leur tiennent à cœur ». « Alors que d’autres groupes d’élèves de l’établissement étaient libres d’exprimer leurs idées, l’école a censuré les tracts de ce club, puis lui a retiré son agrément au motif que les messages qu’ils contenaient étaient trop ouvertement pro-vie. »
Neuvaine pour le respect de l’objection de conscience
Neuvaine pour le respect de l’objection de conscience avec le soutien de Mgr Dollmann, archevêque de Cambrai :
A l’heure où les parlementaires examinent les textes de loi sur la fin de vie, le premier sur les soins palliatifs et le second sur la création d’ un droit à l’aide à mourir, c’est à dire l’euthanasie et le suicide assisté, nous nous tournons de nouveau vers notre Père du Ciel, source et fin de toute vie, avec confiance. Prions cette neuvaine par l’intercession de la Vierge Marie, Patronne de la France, de Saint Joseph, patron de la bonne mort, de Saint Michel Archange, des Saints protecteurs et fondateurs de nos établissements de Santé ainsi que les Saints qui ont défendu la conscience humaine. Demandons que la conscience des législateurs et de tous les Français soit éclairée afin que la Vie soit respectée de son début à sa fin naturelle, ainsi que l’objection de conscience des soignants et des établissements de santé.
La première encyclique du pape Léon XIV évoquera l’intelligence artificielle, le transhumanisme et l’idéologie du genre
Les thèmes de la première encyclique du pape Léon XIV ont fuité : l’intelligence artificielle, le transhumanisme et l’idéologie du genre. Elle sera bientôt entre les mains du cardinal Fernández, préfet du Dicastère de la doctrine de la Foi.
Le 31 janvier, le quotidien italien Il Giornale a révélé qu’une version de la première encyclique de Léon XIV avaient été distribuées quelques jours auparavant. Intitulée provisoirement Magnifica Humanitas (« Magnifique Humanité »), elle abordera l’impact de l’intelligence artificielle, des théories posthumanistes et des technologies de pointe sur la dignité humaine, la justice sociale et le travail. D’après le journaliste italien Fabio Marchese Ragona, le texte décrira la « magnificence de la personne humaine », et plus particulièrement le caractère unique et la valeur du corps humain à une époque de plus en plus marquée par la robotique, l’intelligence artificielle et les technologies cybernétiques. Les autorités vaticanes ont précisé que la décision finale concernant le titre reviendra au pape Léon XIV une fois le texte définitif soumis.
Le processus de rédaction suit les procédures établies du Vatican. Une première version du document a été examinée il y a plusieurs mois, puis renvoyée aux auteurs, restés anonymes, pour des corrections mineures. Après une seconde série de révisions, le texte sera examiné par le cardinal Michel Czerny, SJ, préfet du Dicastère pour le développement humain intégral.
Après examen, le document sera soumis au cardinal Víctor Manuel Fernández, préfet du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, pour « évaluation théologique et ajustements doctrinaux nécessaires ». Une fois ces étapes franchies, la version définitive sera transmise au Secrétariat d’État pour une dernière relecture avant d’être présentée au Pape pour signature.
L’encyclique devrait inclure une analyse critique des théories posthumanistes et transhumanistes. Le document souligne notamment que le corps humain ne saurait être réduit à un simple réceptacle neutre dont les capacités pourraient être indéfiniment augmentées sans conséquences éthiques.
Une attention particulière doit être portée à l’utilisation des nanotechnologies, du génie génétique et autres outils susceptibles d’améliorer ou de modifier les fonctions biologiques humaines. L’encyclique ne rejette pas catégoriquement ces technologies. Le critère proposé est que ces moyens visent à améliorer la santé et à soulager les souffrances des malades, plutôt qu’à créer des êtres humains hybrides ou augmentés.
Le texte aborderait également la question de l’identité de genre et adopterait une position ferme contre les théories qui contestent la distinction biologique entre homme et femme ou qui présentent le genre comme une construction sociale purement mutable.
Quand on plante une croix c’est la marque tranquille d’un monde qui ne sépare pas le profane du sacré, le visible de l’invisible
Après la messe célébrée à Propriano, les participants ont rejoint Savazzida, un imposant bloc granitique d’une altitude de 670 m. Le cardinal Bustillo a déclaré :
“Une croix en ce lieu magnifique n’est pas qu’un repère en hauteur. Elle ne sépare pas, elle relie les hommes entre eux. Ici, prier n’est pas un principe, c’est une manière d’habiter la terre. Le sacré se confond avec la montagne, avec le silence, avec le vent. La foi oublie que les symboles ne sont pas seulement des signes religieux mais des marques d’appartenance et des empreintes d’histoire. Elle ne voit pas que ces signes visibles ne sont pas des affirmations de pouvoir mais des traces de mémoire.”
Un habitant souligne :
“Dans nos villages, chaque pierre raconte une histoire. Une croix, un oratoire, une chapelle isolée, une fontaine ou un vieux mur de maison sont autant de bornes qui disent ”quelqu’un a vécu ici, a aimé ici, a prié ici”. C’est une manière d’inscrire l’humain dans la durée. Quand on plante une croix c’est un peu de notre histoire qu’on perpétue. Elle est la marque tranquille d’un monde qui ne sépare pas le profane du sacré, le visible de l’invisible, la vie de la mémoire.”
La croix a été fabriquée par un artisan du secteur.
Pose et bénédiction d’une croix à Viggianello sous la présidence du cardinal François Bustillo.#eglisedecorse #cardinalbustillo #corsica #benediction #croix
📸 Cathy Acquesta pic.twitter.com/I5QlkYaSnk— Église Catholique en Corse (@egliseencorse) February 1, 2026
L’abbé Celier et l’antilibéralisme catholique
Au micro de « L’invité du Club des Hommes en noir », Philippe Maxence reçoit cette semaine l’abbé Grégoire Celier pour son nouveau livre L’école de l’antilibéralisme catholique (éditions Hora Decima). Dans cet ouvrage, l’abbé Celier retrace avec clarté l’apparition du catholicisme libéral et comment celui-ci s’est constitué en réponse l’antilibéralisme illustré par des noms comme le cardinal Pie, Mgr de Ségur, dom Guéranger, Mgr Gaume, Mgr Benigni, l’abbé Barbier, Mgr Delassus, dom Besse, Mgr Freppel et beaucoup d’autres. Ils montrent la continuité de ces courants et la manière dont ils se sont développés jusqu’à aujourd’hui.
Mais, soumis à la question, l’abbé Grégoire Celier donne un peu à voir qui il est, au-delà de ses engagements et de sa participation régulière au Club des Hommes en noir.